
Illustration: Valéry Goulet
Écoles privées, programmes publics enrichis et classes ordinaires : cette segmentation de l’école québécoise compromet-elle l’égalité des chances ? Des scientifiques étudient la question.
Dès que je le rencontre dans un couloir bordé de casiers de l’école secondaire de la Montée de Sherbrooke, Alain-Guillaume Marcotte-Fournier me prévient de l’ironie de la situation : il enseigne actuellement la biologie à des élèves d’un programme enrichi en sciences. C’est ironique, car, il y a une dizaine d’années, il a fait une pause de l’enseignement pour entreprendre une maîtrise à l’Université de Sherbrooke sur les conséquences négatives de la multiplication de ce genre de projets pédagogiques particuliers.
Avant cette pause, il enseignait à des classes ordinaires. Le fardeau de la tâche semblait s’alourdir : il fallait plus d’énergie pour gérer des troubles de comportement et il y avait moins de temps à allouer aux apprentissages. « Le midi, lorsqu’on se retrouvait autour d’une table entre enseignants, j’entendais des phrases comme : “je n’enverrais jamais mon enfant au régulier”, raconte-t-il. On se disait ça entre nous, mais personne n’agissait. » Il a donc décidé de faire la lumière sur la situation. Le problème était-il dû aux programmes sélectifs, qui dépouillaient ces classes de leurs élèves ayant le plus de facilité à apprendre ?
Durant l’entrevue, ma position m’est aussi apparue ironique : j’appartiens à la première génération instruite dans un programme enrichi à l’école publique. Et le couloir du pavillon Le Ber, où j’ai retrouvé M. Marcotte-Fournier, est celui où se trouvait mon casier lorsque j’étudiais dans la « concentration sciences et informatique ».
Quand j’ai fait le saut du primaire au secondaire en 1995, sept ans seulement s’étaient écoulés depuis que la Loi sur l’instruction publique avait permis aux établissements publics d’offrir des projets pédagogiques particuliers, dans le but de motiver les élèves. Toutes les écoles secondaires publiques de Sherbrooke offraient déjà un programme enrichi qui leur était propre. À partir des années 2000, le phénomène allait s’étendre à l’ensemble de la province.
Voilà qui ajoutait une nouvelle division à celle déjà existante entre les établissements publics et les écoles privées, ces dernières ayant le droit depuis 1968 d’être financées à majorité par l’État et de sélectionner leurs élèves.
L’école privée, le public enrichi et les classes ordinaires forment ce qu’il est désormais coutume d’appeler l’« école à trois vitesses », un système dénoncé comme inégalitaire, d’autant plus que la barrière à l’entrée de certains programmes se complexifie : des notes élevées, des tests psychométriques, des vidéos de présentation et même des frais supplémentaires sont parfois exigés. Le sujet refait surface puisque le Québec s’apprête à revivre une réforme en éducation. Dans une entrevue accordée au Devoir en mai dernier, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, déclarait que les études qui documentent cette « école à trois vitesses » ont « un biais conceptuel ». Qu’en est-il vraiment ?

Illustration: Valéry Goulet
Trier sur le volet
Le tri effectué par le privé et le public enrichi change assurément la composition des classes. Isabelle Plante, professeure au Département de didactique de l’Université du Québec à Montréal, a analysé le passage du primaire au secondaire de 480 jeunes des régions de Saint-Hyacinthe et de Joliette. Son rapport de recherche, publié en 2019, dresse un premier constat : les élèves avec des troubles de comportement sont quasi absents des programmes sélectifs. « Ils ne sont plus répartis dans différentes classes comme ils l’étaient au primaire, souligne-t-elle. Ils se retrouvent ensemble, en petite communauté. Imaginez la tâche de l’enseignant ! »
La chercheuse a aussi noté que moins de garçons sont admis dans les programmes sélectifs, qui accueillent 30 % plus de filles. « C’est la réussite, la motivation et l’engagement en français qui créent ce filtre », explique la titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les différences de genre à l’école.
De plus, ce « marché scolaire » reproduit les inégalités liées à l’origine sociale. C’est ce qui ressort des travaux de Pierre Canisius Kamanzi, professeur agrégé au Département d’administration et fondements de l’éducation de l’Université de Montréal. Ce dernier a analysé les statistiques d’une cohorte de plus de 2500 élèves nés en 1984 et dont le parcours scolaire au Québec a été suivi jusqu’à l’âge de 22 ans.
Dans des articles parus en 2019 dans la Revue des sciences de l’éducation et dans Social Inclusion, le sociologue démontre que la fréquentation des secteurs sélectifs est fortement liée à la scolarité des parents. À l’école privée, 85 % des élèves ont un père ou une mère avec un diplôme collégial ou universitaire. Au public enrichi, c’est 72 %. Cette proportion chute au public ordinaire, où 46 % des élèves sont les enfants de personnes qui ont tout au plus obtenu un diplôme d’études secondaires.
De plus, la segmentation du parcours scolaire semble perpétuer les inégalités. Plus de 90 % des personnes qui ont passé la majorité de leur secondaire à l’école privée ou au public enrichi ont poursuivi des études collégiales après avoir obtenu leur diplôme. Or, moins de la moitié des élèves qui avaient surtout fréquenté les classes ordinaires ont fait ce saut. Le constat est le même pour l’université : 60 % des élèves des écoles privées et 51 % des élèves des programmes enrichis publics y accèdent, contre seulement 15 % pour les élèves des classes ordinaires.
« Si on mettait tout le monde dans le même programme ordinaire ou enrichi, est-ce que la situation changerait ? Oui, affirme sans hésitation Pierre Canisius Kamanzi. Le processus d’apprentissage, de réussite et de performance ne se joue pas seulement dans la matière qu’enseigne le professeur, mais aussi dans les relations qu’entretiennent les élèves. Ils apprennent et performent en fonction des pairs. »
« Lorsque les élèves en difficulté sont dans des groupes avec des élèves plus forts, ils sont plus susceptibles de réussir et d’être motivés. »
Isabelle Archambault, professeure à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal
Effet de groupe
L’influence des voisins et des voisines de pupitre dans la réussite a été mise en lumière après l’adoption aux États-Unis du Civil Rights Act, en 1964. Le département de l’Éducation avait alors demandé au sociologue James S. Coleman d’enquêter sur les inégalités scolaires. Contrairement à ce qui était prévu, son rapport remis en 1966 ne pointait pas un manque de ressources financières dans les écoles des milieux défavorisés. Il soulignait plutôt que l’entourage en classe semblait avoir un grand effet, car les enfants de minorités ethniques réussissaient mieux dans les écoles fréquentées par des familles aisées de la majorité blanche. Fortement critiqué, le rapport a néanmoins lancé un débat dans la communauté scientifique sur l’influence des camarades.
Le Conseil supérieur de l’éducation du Québec, lorsque Claude Lessard en était le président, entre 2011 et 2015, a commandé une synthèse de la recherche sur la mixité et la composition des groupes-classes. Une tendance claire s’en dégage : dans de bonnes conditions, les élèves aux prises avec des difficultés tirent beaucoup d’avantages à côtoyer des jeunes performants, sans pour autant nuire à la réussite de ces derniers. « Ce qui m’a frappé en relisant [cette synthèse], c’est à quel point ces recherches sont peu développées au Québec », déplore toutefois Claude Lessard. Depuis cette publication, des équipes d’ici ont tout de même démontré que le manque de mixité dans le système scolaire québécois cause du tort aux élèves moins favorisés.
Isabelle Archambault, professeure à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal, a remarqué un cercle vicieux. Dans un chapitre du livre Inequality in Key Skills of City Youth: An International Comparison, publié en 2023 par l’American Educational Research Association, elle analyse avec des collègues les données concernant 4000 jeunes âgés de 15 ans dans 36 écoles montréalaises. « Les élèves de milieux défavorisés sont plus susceptibles de présenter des difficultés et donc de fréquenter des écoles avec plus d’élèves en difficulté, explique-t-elle. La capacité de ces milieux à soutenir ces élèves devient alors plus limitée. Cela fait en sorte qu’ils vont finalement éprouver encore plus de difficultés. »

Photo: Shutterstock
L’ajout d’un programme enrichi dans la même polyvalente, si sa cohorte reste en vase clos, n’aide pas pour autant. « Il est démontré que c’est souvent ce qui se passe à l’intérieur même des groupes qui a une répercussion importante, parce que c’est là que les matières sont transmises, souligne Isabelle Archambault. Lorsque les élèves en difficulté sont dans des groupes avec des élèves plus forts, ils sont plus susceptibles de réussir et d’être motivés. »
Mais qu’arrive-t-il lorsque ces élèves sont séparés dans des classes distinctes ? Au moment d’analyser les notes officielles et les informations amassées à l’aide de questionnaires dans les régions de Saint-Hyacinthe et de Joliette, Isabelle Plante s’attendait à observer un phénomène de « gros poisson, petit bassin ». Selon cette théorie, les élèves perçus comme les meilleurs dans leur école primaire risquaient de voir leur estime d’eux-mêmes diminuer une fois en compagnie d’élèves plus forts dans un programme sélectif. La chercheuse prévoyait donc une chute dans la motivation et le rendement de ces jeunes lors de leur transition au secondaire. « On a observé absolument l’inverse », lance Isabelle Plante. Elle raconte avoir cru un moment qu’elle avait entré les données à l’envers, tant sa surprise a été grande. « En fait, il y a un effet d’assimilation pure et dure. Les élèves qui vont dans les programmes sélectifs sont tirés vers le haut et des élèves qui avaient un dossier équivalent initialement sont tirés vers le bas dans le public ordinaire. »
Durant sa maîtrise, Alain-Guillaume Marcotte-Fournier a aussi décelé un effet de la composition des groupes sur le rendement scolaire. Assis dans un local de science, il me montre sur un ordinateur les cartes de Sherbrooke dans l’Atlas de la défavorisation. C’est à partir d’elles que le ministère de l’Éducation alloue du financement aux établissements de milieux jugés défavorisés. Les zones liées aux codes postaux se colorent selon le niveau socioéconomique relevé dans le recensement.
L’enseignant a creusé ces données pour comparer 968 élèves de 2e secondaire. Il a examiné pour chaque élève des facteurs individuels, comme le sexe, la note à un examen uniforme de mathématiques en sixième année et l’indice de défavorisation, mais aussi la composition du groupe classe.
D’emblée, les données révélaient que les groupes ordinaires accueillent de manière disproportionnée les élèves issus de milieux défavorisés. Mais surtout, son analyse montre que, lorsque deux élèves présentent les mêmes caractéristiques individuelles, celui ou celle qui se trouve dans un groupe où la moyenne des élèves est plus défavorisée présente un moins bon rendement en mathématiques en 2e secondaire. L’écart peut atteindre près de 14 % du seul fait que l’élève se retrouve dans le groupe le plus favorisé ou le plus défavorisé.
« Ça reste les variables individuelles qui expliquent le plus la réussite, nuance l’enseignant. Mais le niveau de défavorisation du groupe-classe a un effet. »
Une partie de ces résultats pourrait s’expliquer par l’attitude des enseignants et enseignantes. Dans une étude publiée en 2012 dans The Journal of Educational Research, Isabelle Archambault dévoilait que les attentes rapportées par le personnel enseignant avaient une incidence directe sur les résultats scolaires. Un phénomène attribuable à ce que la psychologie désigne comme une prophétie autoréalisatrice. Un autre article qu’elle a cosigné en 2014 établissait un lien entre ces attentes et la composition du groupe. « Dans deux milieux comparables, des attentes élevées des enseignants envers leurs élèves sont associées à une meilleure réussite de ces derniers, explique-t-elle. Mais en milieu défavorisé, ou même en milieu favorisé pluriethnique, les attentes sont plus faibles par rapport à la capacité des élèves du groupe à réussir. »
« Pour que les adultes et citoyens de demain vivent ensemble dans le même quartier, dans le même moyen de transport et dans le même milieu professionnel, il faut préparer ce vivre-ensemble à l’école. »
Pierre Canisius Kamanzi, professeur agrégé au Département d’administration et fondements de l’éducation de l’Université de Montréal
Contenter tout le monde
Philippe Tremblay, professeur au Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage de l’Université Laval, remarque d’ailleurs une tendance des enseignants et des enseignantes à baisser leurs exigences quand ils jugent être en présence d’un groupe d’élèves faibles.
Il parle même d’une « école à quatre vitesses », en déplorant l’existence de classes spéciales accueillant seulement des élèves avec des problèmes d’apprentissage. « Ces classes sont souvent les mieux dotées en ressources, mais c’est une très mauvaise idée de mettre tous ces élèves ensemble. »
Pour les intégrer dans des classes hétérogènes, le coenseignement au premier cycle du secondaire constitue selon le chercheur une solution. Cela implique de faire intervenir une ressource spécialisée devant la classe au moment de livrer certains apprentissages. « On pense que le professeur aussi est en difficulté, ajoute Philippe Tremblay. Si j’aide l’enseignant, j’aide l’élève. » La ressource en renfort profite également aux élèves avec de bonnes notes, car il devient possible d’adapter les interventions selon les forces et les difficultés de chacun tout en gardant des exigences élevées.
Le chercheur a mené un projet de recherche-action à l’école secondaire de l’Odyssée, à Terrebonne. Des élèves en classe spéciale pour problèmes d’apprentissage en 1re secondaire ont pris deux voies différentes en 2e secondaire. Une partie est retournée dans une classe spéciale, alors que l’autre s’est retrouvée dans une classe ordinaire avec du coenseignement. Les résultats, qui n’ont pas encore été publiés, montrent un effet jusqu’en 5e secondaire : quasiment aucun élève ayant bénéficié du coenseignement trois ans plus tôt n’avait abandonné l’école. En revanche, le tiers de ceux et celles qui étaient restés en classe spéciale avait décroché.

Photo: Shutterstock
Philippe Tremblay donne aussi l’exemple du centre éducatif L’Abri de Port-Cartier, où il mène un autre projet. Cet établissement offre un seul parcours à presque tous ses élèves et du coenseignement à temps plein dans les classes de français, de mathématiques et d’anglais de 1re et de 2e secondaire.
D’autres établissements, comme l’école secondaire de la Ruche à Magog, offrent plutôt des projets particuliers à l’ensemble des élèves durant les trois premières années, tout en les mélangeant dans leurs cours obligatoires. Mais ces écoles demeurent des exceptions.
Alain-Guillaume Marcotte-Fournier raconte avoir rencontré une résistance de la part de membres de directions scolaires à l’idée de réunir les élèves des programmes ordinaires et enrichis dans certains cours de tronc commun. Les arguments évoqués ? La complexité de créer de tels horaires et le risque de voir les parents inscrire leurs enfants dans d’autres établissements à proximité.
C’est justement après avoir échoué à convaincre des parents de Gatineau d’envoyer comme lui leurs enfants à l’école primaire du quartier que Stéphane Vigneault a lancé le mouvement citoyen École ensemble. L’appel de l’école internationale était trop grand pour son voisinage. « Je me suis rendu compte qu’on s’attaquait à quelque chose de très gros », dit-il. École ensemble revendique aujourd’hui un système dans lequel les écoles offriraient des parcours particuliers à tous et à toutes, et sans pouvoir sélectionner leurs élèves.
« Cela ne sert à rien de blâmer les parents, souligne Stéphane Vigneault, dont la fille fréquente aujourd’hui le public sélectif au secondaire. Tout le monde cherche ce qu’il y a de mieux pour ses enfants et fait ce qu’il peut avec le système. »
Un système qu’une méta-analyse publiée en 2023 dans Review of Educational Research invite à remettre en question. Des scientifiques de l’Université de Trente, en Italie, y observent que la segmentation en programmes est en général inefficace du point de vue éducatif, qu’elle accroît les inégalités scolaires et pénalise les élèves défavorisés. Leur conclusion ? Des réformes qui diminuent le nombre de filières ou atténuent leurs distinctions ont le potentiel de réduire les inégalités liées aux origines sociales, sans nuire à la réussite globale des élèves.
Le gouvernement du Québec ne semble pas aller dans cette direction. Il a plutôt annoncé en mai 2023 le démantèlement du Conseil supérieur de l’éducation, qui l’invitait en 2016 à adopter des mesures pour augmenter la mixité sociale dans les classes et les écoles. Dans la foulée, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a annoncé la création d’un Institut national d’excellence en éducation, dont la mission sera de faire la synthèse des approches pédagogiques démontrées comme efficaces par la recherche pour former le personnel. « Il y a beaucoup de cynisme chez les enseignants, constate Alain-Guillaume Marcotte-Fournier. On parle d’un gouvernement qui veut nous montrer les meilleures façons d’enseigner avec des données probantes. C’est plate, mais je vais avoir de la difficulté à y adhérer si on ne tient pas compte du fait que les groupes que j’ai devant moi, et l’organisation de ces groupes, influencent beaucoup la pédagogie. »
Il rappelle qu’en plus d’« instruire » et de « qualifier » les jeunes, l’école québécoise a officiellement comme mission de les « socialiser ».
« Ma principale préoccupation, c’est que l’école soit un instrument de cohésion sociale, confie d’ailleurs Pierre Canisius Kamanzi. Pour que les adultes et citoyens de demain vivent ensemble dans le même quartier, dans le même moyen de transport et dans le même milieu professionnel, il faut préparer ce vivre-ensemble à l’école. »
Les programmes sélectifs : sources d’anxiété ?

Illustration: Valéry Goulet
Regrouper les élèves les plus habiles au sein d’un même programme sélectif exacerbe-t-il l’anxiété de performance chez ces derniers ? La science montre plutôt qu’il faudrait d’abord se préoccuper de ce problème dans les classes ordinaires. « Il y a plus d’anxiété de performance dans les milieux publics ordinaires que dans tous les autres milieux, dont le privé, souligne Isabelle Plante, qui a mené des recherches sur le sujet. Les élèves qui ont des notes autour de 65 % ou 70 % sont massivement plus à risque d’atteindre les niveaux les plus élevés d’anxiété. »
Elle constate une remontée de l’anxiété chez les perfectionnistes dont les résultats dépassent 90 %, mais celle-ci ne se manifeste jamais avec la même intensité ni par des symptômes physiques aussi graves. « On sous-estime fortement l’anxiété évaluative chez les élèves qu’on va qualifier d’opposants, de négligents, de démotivés. Ils ont adopté des stratégies comme la procrastination parce qu’ils ont appris que l’évaluation était une menace, remarque-t-elle. Ils ont des maux de ventre ou des maux de tête le matin de l’examen. Ce sont des élèves qui ont vraiment un risque d’échouer. » Après tout, rappelle-t-elle, en général, « plus on fait de l’anxiété, moins on performe ». Une meilleure mixité des classes briserait-elle ou amplifierait-elle ce cycle ? La question reste ouverte !
Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, qui finance les travaux de chercheuses et chercheurs d’ici, dont certains cités dans ce texte, soutient financièrement Québec Science dans sa mission de couvrir des sujets liés aux sciences humaines. Le magazine conserve son indépendance dans le choix et le traitement des sujets.





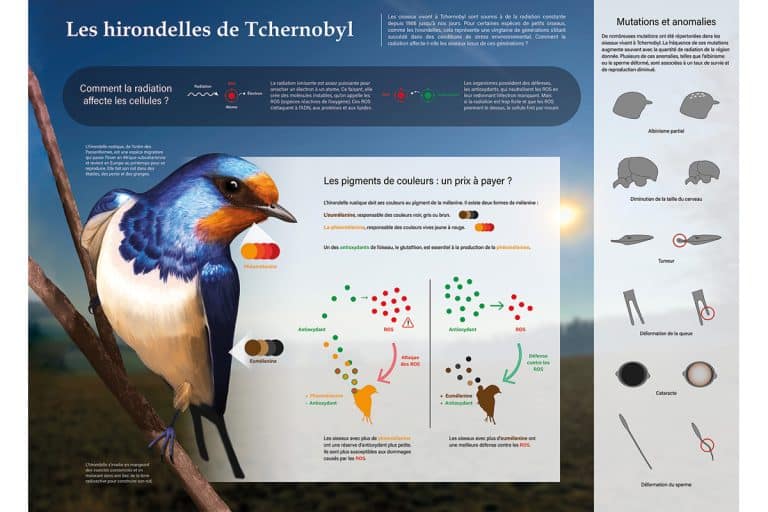


C’est connu: enlever des élèves des classes régulières, c’est réduire le développement du groupe régulier. Car les élèves plus forts stimulent le groupe. Cela a été scientifiquement illustré par Centre Simon-Wiesenthal
https://fr.wikipedia.org › wiki › Centre_Simon-Wiesen…
Le centre est impliqué dans les actions de l’Unesco, à la fois dans les outils pédagogiques utilisés pour promouvoir la tolérance et la compréhension ….