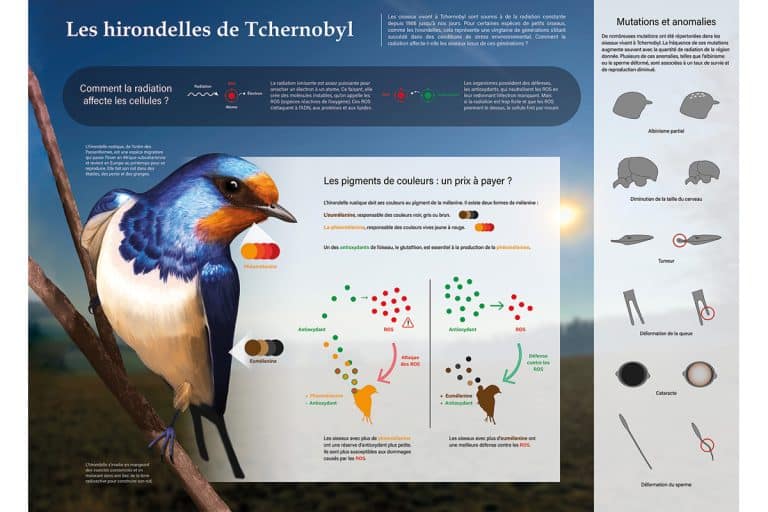Donner un rôle aux non-scientifiques dans la recherche pour mieux répondre aux besoins de la « vraie vie » : c’est le principe de la recherche participative, une approche qui a le vent en poupe.
Si Johanne Gagnon a accepté d’être consultée à plusieurs reprises pour co-organiser des recherches portant sur des questions de pauvreté et d’accès à l’alimentation, c’est qu’elle voulait être sûre que ces travaux serviraient. « Pas que ça terminerait sur une tablette », lance-t-elle. Cette résidente de Limoilou, à Québec, fréquente L’Évasion Saint-Pie X, un organisme qui accompagne des personnes vivant des problèmes d’ordre économique, psychologique ou social. C’est par l’entremise de celui-ci qu’elle a eu vent d’un projet visant à favoriser l’inclusion de personnes non universitaires dans l’élaboration d’études scientifiques. En tant « qu’experte du vécu », comme on dit dans le jargon, elle a joué un rôle actif à toutes les étapes, dépassant largement la consultation. En a résulté un guide pratique « toujours utile dix ans plus tard », affirme-t-elle.
Quand elle en a l’occasion, cette mère de famille de 49 ans prend part à l’organisation d’autres études sur des sujets qui la concernent directement. « On participe à des projets [de recherche universitaire] parce qu’on veut qu’ils aboutissent à des services adaptés à nos besoins. Ça nous donne une voix quand on n’en a pas. Et ça m’a permis de comprendre que je suis pas mal moins niaiseuse que ce que je pensais et que j’ai des capacités d’analyse. »
L’idée d’impliquer une communauté concernée par un problème dans toutes les étapes de la recherche s’inspire, entre autres, de l’approche de croisement des savoirs. Développée en 1957 par le mouvement de lutte contre la pauvreté ATD Quart Monde, elle conçoit que « toute personne, même la plus démunie socialement, détient potentiellement les moyens de comprendre et d’interpréter sa propre situation et celle de son environnement ». La recherche participative propose ainsi de tirer avantage de la complémentarité des savoirs plutôt que de les hiérarchiser. La science ne doit pas se faire à sens unique : elle a aussi besoin de prendre le pouls de la société pour aller dans la bonne direction.
Le concept a fait ses preuves en santé, où les recherches communautaires ont gagné en popularité dès les années 1980, privilégiant une démarche d’étude « avec » plutôt que « sur » les patients et patientes. Aujourd’hui pratiquée dans une grande variété de champs scientifiques, la recherche participative gagne notamment du terrain dans des projets ciblant des groupes défavorisés. Cette voie privilégiée pour répondre à des problèmes concrets a le vent dans les voiles.
En toute cohérence
Titulaire de la Chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé (RISS), Janie Houle considère les « experts du vécu » comme des « pairs chercheurs ». Cinq personnes en situation de pauvreté siègent au comité de gouvernance de la Chaire RISS. « Il faut être cohérent entre nos visées et les processus mis en place pour y parvenir. Réduire les inégalités sociales passe par un partage du pouvoir, des ressources et des richesses : ça doit s’incarner jusque dans notre structure », explique la professeure au Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal et membre du Centre de recherche sur les innovations sociales.
Elle amorce en 2025 une « recherche-action participative » avec des comités consultatifs de locataires en HLM pour étudier les processus de prise de décision et déterminer les bonnes pratiques. Et elle lance en parallèle un projet visant à modéliser le coût des changements climatiques sur la santé de la population et sur le réseau de la santé. « Le lien entre changements climatiques et accroissement des inégalités sociales est considéré comme un enjeu majeur de santé publique. Lors d’épisodes de chaleur extrême, les personnes en situation de défavorisation ont plus de risques de mourir ou de voir leur état de santé s’aggraver », avance Janie Houle.
Six ou sept personnes en situation de défavorisation socio-économique et ayant été fortement affectées par des épisodes de chaleur seront membres du comité consultatif. Elles contribueront à élaborer les procédures de collecte de données et de recrutement, à interpréter et à diffuser les résultats. « En tant que chercheurs, nous avons inévitablement des angles morts, des réalités qu’on sous-estime ou qu’on ne soupçonne pas. Nos pairs chercheurs s’assureront que nos questions et nos observations n’éludent pas de dimensions importantes », indique la directrice associée du tout nouveau Réseau de recherche sur les savoirs citoyens et les approches cocréatives au Québec (RéSCits), lancé fin 2024 à l’initiative de plusieurs institutions de recherche de la province.
Reconnaître le travail à sa juste valeur
Formations, rencontres, analyse et diffusion de résultats : l’implication dans un projet demande du temps. Comment rétribuer les personnes qui s’impliquent sans que ce soit pour autant leur métier ? La chaire RISS offre une compensation de 24 $ l’heure. Du côté de la Maison de Marthe, on propose une allocation de 50 $ par rencontre. Dans le cadre du projet Vers une autonomie alimentaire pour touTEs : Agir et vivre ensemble le changement (VAATAVEC), Johanne Gagnon recevait 40 $ par rencontre. Souvent, les déplacements sont pris en charge, et un repas est offert. « La question de la rémunération est fondamentale, dit Marietou Niang. Il faut que les experts du vécu se sentent reconnus et continuent à vouloir s’investir. » Ces dernières années, plusieurs scientifiques ont fait des démarches auprès du gouvernement québécois afin d’éviter que les prestations d’aide sociale soient amputées à cause des compensations financières. « Il y avait toujours une crainte que les gens se fassent réduire leurs maigres prestations quand ils participaient à la recherche. On a obtenu que la participation ne soit pas considérée dans le calcul des prestations », explique Janie Houle.
Implication maximale
Depuis 2013, le Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural agit au sein de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Composé de chercheurs et chercheuses, de personnes expertes du vécu et expertes de la pratique, il émane « d’intervenants du milieu communautaire désireux de donner plus de voix aux personnes concernées par la pauvreté ».
« La recherche participative est un continuum, allant de la collaboration sporadique à la participation maximale à toutes les étapes », explique Marietou Niang, professeure de travail social et directrice scientifique du collectif. La chercheuse se positionne du côté maximal du spectre, à l’instar de Janie Houle pour qui « il faut éviter d’instrumentaliser les personnes. Le terme “participatif” est parfois galvaudé. Certaines personnes rapportent avoir vécu le phénomène de la plante verte. Elles ne veulent pas servir à faire bien paraître une démarche qui leur échappe, mais veulent pleinement prendre part aux décisions ».
Corinne Vézeau partage cette préoccupation d’inclusion maximale. La coordonnatrice de projet à la Maison de Marthe, un organisme communautaire qui soutient les femmes en processus de sortie de la prostitution, a chapeauté un projet d’hébergement au sein de l’organisme. Soucieuse d’en évaluer les retombées, elle a fait appel à Lucie Gélineau, professeure au Département de travail social à l’UQAR et adepte de la recherche participative.
Les outils de collecte de données et les grilles d’analyse ont été élaborés avec des femmes fréquentant l’organisme, au fil de 22 rencontres. « Leur participation a permis de bonifier nos analyses et a mené à des résultats plus significatifs, estime Corinne Vézeau. On a simplifié des énoncés ainsi que la structure de nos questionnaires, modifié des questions pour qu’elles correspondent mieux à la réalité. Par exemple, depuis notre position de chercheuse ou d’intervenante, on a une conception de ce que veut dire reprendre du pouvoir sur sa vie. Les femmes survivantes en ont une autre. Comme intervenantes, on pensait d’emblée à des choses comme avoir plus d’autonomie, de sécurité financière. Pour elles, ça s’incarnait d’abord par le fait de retrouver le plaisir de vivre. Il fallait donc que cette notion fasse partie de notre grille d’analyse. » Un processus valorisant pour les participantes, résumé ainsi par l’une d’elles : « On passe d’être utilisées à être utiles. »
Trouver un langage commun
Pour s’entendre, il est primordial de vulgariser pour que des personnes peu scolarisées comprennent ce que les scientifiques veulent dire. « Pour certaines études, on a présenté nos résultats préliminaires aux co-chercheuses sous forme de graphiques ou d’illustrations, explique Pascaline Lebrun, responsable de la programmation scientifique au Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural. Ça donnait une base d’analyse accessible à tout le monde, à partir de laquelle on pouvait affiner les données. »
S’approprier une méthodologie commune de recherche ne va pas forcément de soi. Corinne Vézeau a joué le rôle de trait d’union quand c’était nécessaire. « Je connaissais les chercheuses et je connaissais les expertes du vécu. Tout le monde n’arrivait pas aux réunions dans le même état affectif. Il fallait parfois laisser le temps à chacune de se déposer avant de s’attaquer à l’ordre du jour. Il ne faut pas ignorer la dimension socio-affective. »
Pas plus qu’il ne faut invisibiliser les enjeux de pouvoir intrinsèques à la démarche participative, affirme Marietou Niang. « C’est une question de justice sociale. Savoir, c’est pouvoir. Or, qui détient le savoir, comment circule-t-il, est-il accessible ? » demande la professeure. La recherche participative a aussi cette visée de lutter contre les injustices découlant de savoirs ‒ donc de pouvoirs ‒ pas toujours distribués avec équité. « Reste qu’on n’arrive jamais tout à fait à faire disparaître le déséquilibre de pouvoirs dans l’équipe, observe Janie Houle. Ça peut créer des tensions au sein du groupe, il faut être prêt à les désamorcer. »
Johanne Gagnon peut en témoigner. « On n’est pas nécessairement à l’aise pour parler avec des experts de la pratique et des chercheurs. Ce qui est important dans ces groupes-là, c’est que la magie se passe, qu’on ne se sente pas “moins”. À mesure qu’on avance dans le travail, des liens se créent, et on se sent à la même hauteur que tout le monde. »
Photos prises lors de rencontres du projet « Vers une société plus juste », une des études participatives de Janie Houle. Le but : décrire la réalité des personnes recevant des prestations d’assistance sociale, entre autres. L’équipe de recherche et les « pairs chercheurs » travaillent de concert. Photos : Max Dufaud
De la recherche à l’action
Martine Turgeon est directrice du Centre-Femmes de Lotbinière et membre du Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural, rattaché à l’UQAR. En 2016, avec d’autres organismes communautaires, elle a été à l’origine d’une cartographie de l’offre alimentaire dans Chaudière-Appalaches. En 2021, pour une deuxième phase du projet, l’appui de l’UQAR a permis d’affiner l’analyse des données récoltées par les organismes. « Nous sommes restés maîtres d’œuvre, mais ça a renforcé la crédibilité et les retombées de nos travaux. Bien documentés, les enjeux de sécurité alimentaire de notre région ont été davantage pris en considération », estime Martine Turgeon. Sans attribuer exclusivement à ce partenariat l’ouverture du Marché Saint-Louis en 2022, épicerie de proximité intégrée au pôle agroalimentaire de Lotbinière, elle considère que la bonification des données y a certainement contribué.
Une scientificité enrichie
La participation de personnes non chercheuses à la production de la science remet-elle en question sa validité ? Christine Couture entend cette question depuis ses débuts comme doctorante, en 1994. La professeure en sciences de l’éducation à l’Université du Québec à Chicoutimi défend elle aussi l’approche collaborative (qu’elle mène pour sa part avec des enseignantes et enseignants). « Notre expertise de chercheurs n’est pas supérieure, mais plutôt complémentaire. J’ai des connaissances à partager, les enseignants en ont d’autres. C’est le maillage des expertises qui doit prévaloir. » Selon elle, « une approche théorique inspirée de méta-analyses peut être intéressante sur papier, mais irréaliste dans la pratique ». À l’inverse, « quand on fait de la recherche participative qualitative, on n’a pas de prétention de généralisation. Mais on développe des savoirs et des solutions adaptées aux besoins ».
Mettre savoirs universitaires et savoirs expérientiels sur un pied d’égalité ne nuit pas à la rigueur, estime également Marietou Niang. « Qu’on l’admette ou pas, toute recherche est politique. La recherche participative remet en question la neutralité et l’objectivité du positivisme scientifique. C’est une école de pensée. »
En se connectant ainsi au terrain, à la « vraie vie », les études participatives permettent surtout de mieux cerner les problématiques. « Les projets de recherche participative prennent beaucoup plus de temps, sont plus complexes pour plein de raisons, mais, souvent, on est beaucoup plus proches de ce dont les gens ont besoin », confirme Pascaline Lebrun.
Ils permettent aussi de mieux comprendre des populations « qu’on se plaint d’avoir de la misère à rejoindre, renchérit Janie Houle. On souhaite que la société québécoise bénéficie des retombées de la recherche par des améliorations concrètes dans les politiques publiques. Or, on a plus de chances que la recherche serve si les détenteurs de connaissances ont eu leur mot à dire. Inclure des non-universitaires dans les choix, la méthodologie, l’interprétation et la diffusion des résultats, ça ne peut qu’améliorer la science ».
Photo: Shutterstock
Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, qui finance les travaux de chercheuses et chercheurs d’ici, dont certains cités dans ce texte, soutient financièrement Québec Science dans sa mission de couvrir des sujets liés aux sciences humaines. Le magazine conserve son indépendance dans le choix et le traitement des sujets.