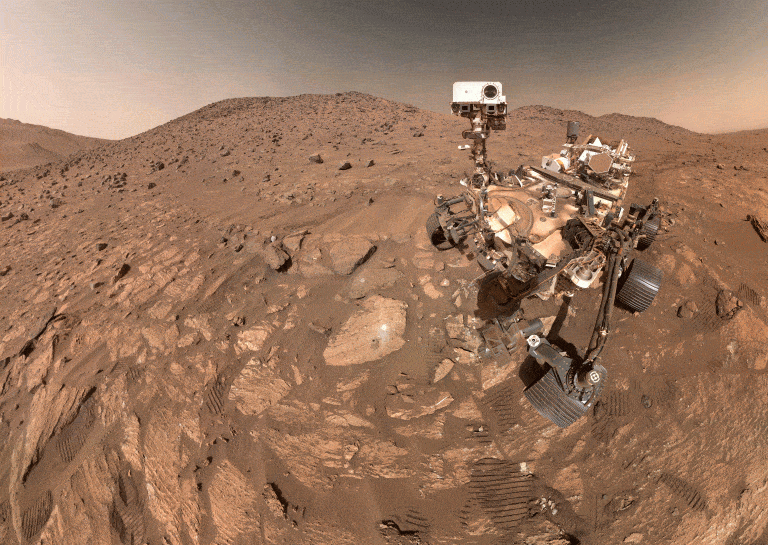Pierre-Henri Tavoillot. Crédit: FPA_NB
C’est à cette question que s’attaque Pierre-Henri Tavoillot, philosophe et enseignant à la Sorbonne Université, dans son plus récent ouvrage Voulons-nous encore vivre ensemble ?, publié en 2024 aux Éditions Odile Jacob. Dans le cadre de sa participation aux Grandes Conférences de l’Université du Québec à Trois-Rivières, il a accordé un entretien à Québec Science.
Québec Science La crise de la COVID-19 est le point de départ de vos réflexions. Qu’a-t-elle révélé selon vous ?
Pierre-Henri Tavoillot La pandémie a constitué une expérience partagée à l’échelle du monde, avec le confinement, la distanciation sociale, l’isolement. Bien sûr, chacun l’a vécue différemment, mais tout le monde a été confronté à une même situation inédite, qui a permis de se demander : qu’est-ce qui me manque vraiment ? Qu’est-ce qui, au contraire, ne me manque pas ? Cela a été extrêmement douloureux, mais ce fut aussi une expérience philosophique partagée sur le sens de notre vie commune. Et ce que cela a révélé, c’est la bizarrerie de nos « sociétés d’individus ». C’est une formule étrange, car une société suppose de vivre avec les autres, mais l’individualisme renvoie au repli sur soi. D’un côté, la tentation de la solitude ; de l’autre, la séduction du conflit. Ce sont, selon moi, les deux grandes menaces qui pèsent sur la vie commune.
QS Vous écrivez « la vie commune est plus exigeante que le vivre ensemble ». Qu’entendez-vous par là ?
PHT En France, on parle beaucoup du « vivre ensemble », mais ce n’est pas une expression que j’aime beaucoup. On peut vivre ensemble côte à côte, sans jamais se parler, dans l’indifférence totale. On peut aussi vivre face à face, dans l’adversité, ou même dos à dos, dans le rejet. Ce qui m’intéresse, c’est moins le fait de vivre ensemble que la volonté de le faire. Dans une démocratie, on ne se contente pas de l’état de fait, on a besoin d’une adhésion, d’un choix délibéré. Le contrat social repose sur ce vouloir commun. La vraie question est donc : voulons-nous encore vivre ensemble ? Et si oui, sur quoi repose ce vouloir ? C’est une interrogation qui n’est pas seulement politique, mais presque existentielle. On peut la comparer à une relation de couple, quand vient une crise, il faut se demander pourquoi on veut continuer, quelles sont les raisons profondes qui justifient ce choix. Aujourd’hui, nos sociétés sont confrontées à cette même mise à l’épreuve.
QS Quelles pistes de réponse proposez-vous ?
PHT J’ai voulu explorer des terrains très concrets, que j’appelle les « sept piliers de la convivialité » que sont la nourriture, la vie de couple, la vie sexuelle, la famille, le travail, le débat public et la spiritualité. Selon moi, ce sont des espaces d’expérience commune qui nous disent si nous avons encore un socle partagé. Prenons l’exemple de la nourriture. En France, on passe en moyenne plus de deux heures par jour à table ; manger ensemble est un moment de sociabilité. La famille, elle, traverse toutes les générations, qu’on soit parent ou enfant. Le couple reste une aspiration universelle, quelle qu’en soit la forme. Le travail demeure aussi un horizon fort, en particulier pour les jeunes, qui veulent qu’il ait du sens. Si j’arrive à prouver que, dans ces piliers, il existe quelque chose de cette réponse commune qui continue de fonctionner et de tenir, alors il y a de l’espoir.
QS Êtes-vous optimiste ? Pensez-vous que la société française (et, plus largement, occidentale) veuille encore « vivre ensemble » ?
PHT Je réponds oui, même si l’inquiétude est réelle. On ne peut pas être naïf. Mais je crois que les démocraties ont encore les ressources pour répondre à cette crise. L’individualisme, à mes yeux, est une conquête positive. Il a permis à chacun de s’émanciper des contraintes communautaires et familiales, de choisir sa vie, son destin. Mais une fois que nous avons fabriqué des individus, il faut encore fabriquer de la société. C’est ça, le nouveau défi. Je choisis donc de répondre « oui », avec la conviction que la clé réside dans la notion d’adulte. Être adulte, c’est reconnaître que l’on a été aidé à grandir et qu’à son tour, on a la responsabilité de faire grandir les autres. Pour moi, c’est le cœur du projet démocratique : grandir et faire grandir. C’est un beau dessein.