Les familles des enfants décédés dans les « pensionnats indiens » cherchent les dépouilles de leurs proches depuis des années. Où sont-ils enterrés ? Comment sont-ils morts ? Avec l’aide de techniques comme le géoradar, de nombreuses communautés espèrent enfin avoir des réponses. Elles s’entourent parfois de scientifiques qui les appuient dans leurs démarches.
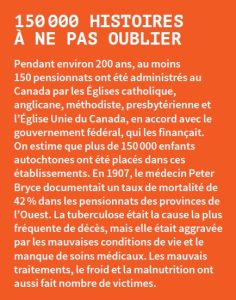 Elles se comptent déjà par centaines, mais il y en a assurément plusieurs milliers. D’un océan à l’autre, des tombes d’enfants autochtones « non marquées », c’est-à-dire sans pierre tombale, ni nom, ni même parfois de signe pour les repérer, sont répertoriées petit à petit aux abords d’anciens pensionnats, ces écoles où l’on envoyait de force les enfants autochtones pour les assimiler à la culture euro-canadienne. S’ils mouraient dans ces établissements, les dépouilles n’étaient pas restituées aux familles. Souvent, aucun avis de décès ne leur était même transmis.
Elles se comptent déjà par centaines, mais il y en a assurément plusieurs milliers. D’un océan à l’autre, des tombes d’enfants autochtones « non marquées », c’est-à-dire sans pierre tombale, ni nom, ni même parfois de signe pour les repérer, sont répertoriées petit à petit aux abords d’anciens pensionnats, ces écoles où l’on envoyait de force les enfants autochtones pour les assimiler à la culture euro-canadienne. S’ils mouraient dans ces établissements, les dépouilles n’étaient pas restituées aux familles. Souvent, aucun avis de décès ne leur était même transmis.
Si le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) estime qu’environ 4100 enfants ayant fréquenté les pensionnats n’en sont jamais revenus (un nombre probablement sous-estimé), les proportions monstrueuses du drame ont éclaté au grand jour au printemps 2021. Coup sur coup, plusieurs Premières Nations ont annoncé des chiffres terrifiants après des recherches par géoradar : la nation Tk’emlúps te Secwépemc a rapporté la présence de 215 « tombes d’enfants » sur le terrain de Kamloops, en Colombie-Britannique ; dans la même province, autour de l’ancienne St. Eugene’s Mission School, 182 tombes potentielles ont été détectées par la nation Ktunaxa ; et le nombre de 751 a été avancé par la Première Nation de Cowessess, en Saskatchewan, sur le site de l’ancien pensionnat de Marieval.
Ce décompte funèbre n’a cessé d’augmenter depuis, un douloureux travail de recherche ayant été mis en branle par une centaine de communautés autochtones. Entreprises par les survivants et survivantes et par les proches des disparus, les démarches sont soutenues par plusieurs scientifiques, qui mettent leur temps et leur expertise en matière de prospection géophysique et de recherche d’archives au service de cette cause. « Cela fait partie du rôle social de l’université. La science doit être au service de la réconciliation », estime Adrian Burke, professeur au Département d’anthropologie de l’Université de Montréal. Il fait partie d’un groupe de 16 archéologues membres de l’Association canadienne d’archéologie (ACA), mis sur pied par Kisha Supernant, la directrice de l’Institut d’archéologie des Prairies et des Autochtones, à l’Université de l’Alberta. Leur but : conseiller, assister et soutenir les communautés dans leurs recherches.

Pensionnat de Kamloops, 1930. Photo: Wikimedia Commons
Une enquête complexe
Ce renfort universitaire n’est pas de trop, car rien n’est simple dans cette quête. Au-delà de la souffrance encore vive, les communautés se heurtent à de nombreux obstacles.
Repérer des restes humains dans des cimetières improvisés est une tâche difficile. En octobre dernier, Adrian Burke s’est rendu auprès de la communauté crie de Chisasibi sur l’île de Fort George, dans le Nord-du-Québec, qui abritait deux des plus gros pensionnats de la province (le site a été abandonné en 1980, en raison de l’érosion causée par les barrages hydroélectriques). « La première étape a consisté à tout cartographier, notamment avec d’anciennes photos aériennes géoréférencées. Avec le GPS, on sait maintenant à 10 cm près où étaient les bâtiments, explique le chercheur. La deuxième étape est un relevé géoradar assez standard. »
Les géoradars sont des appareils mobiles, de la taille d’une tondeuse, qui sondent le sol en envoyant des ondes radio, lesquelles sont réfléchies par les structures sous la surface. Contrairement à ce qu’ont rapporté certains médias, ces coups de sonde ne permettent pas de « voir » des restes humains, mais plutôt de déceler des « anomalies », qui peuvent avoir été causées par une excavation, par exemple.
Mais l’interprétation est délicate. « Dès 2021, plusieurs firmes privées ont voulu faire du profit en proposant leurs services de géoradar aux Premières Nations, sans respecter les bonnes pratiques ni avoir les compétences pour interpréter les données », déplore William Wadsworth, étudiant au doctorat en archéologie à l’Université de l’Alberta. Membre engagé du groupe de travail de l’ACA, il conduit des analyses géophysiques à la demande de la Première Nation de Chipewyan Prairie. « Nous sommes peu d’archéologues formés à cette approche, donc nous essayons autant que possible de former des techniciens dans les communautés », explique le jeune chercheur.
Le groupe de travail a aussi élaboré des recommandations, des protocoles techniques et des vidéos pour conseiller les Premières Nations qui souhaitent mener des recherches. Mais ce travail de terrain suffit rarement à redonner un nom aux individus reposant dans ces tombes de fortune. « Beaucoup d’enfants sont enterrés à 20 ou 30 dans des fosses communes, y compris dans les cimetières municipaux. Personne ne sait s’ils ont été incinérés, s’il y a une urne, s’ils sont dans un linceul, dans un cercueil, seuls ou à plusieurs », souligne Kimberly Murray, avocate membre de la nation mohawk de Kanesatake, qui assume les fonctions d’interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les sépultures anonymes en lien avec les pensionnats pour Autochtones.
Nommée par le gouvernement fédéral en juin 2022 pour un mandat de deux ans, elle remettra son rapport final à Ottawa en juin prochain, notamment pour proposer un cadre juridique permettant le traitement respectueux des sépultures. « Mon rôle consiste à identifier les barrières qui entravent les recherches et à tenter d’y remédier », explique-t-elle.
Naviguer dans les archives
Et des barrières, il y en a. Dans son rapport provisoire publié en juin 2023, Kimberly Murray recense 12 préoccupations exprimées par les communautés. L’une des plus importantes concerne l’accès aux archives, conservées entre autres par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, ainsi que par les Églises et les établissements médicaux. Les documents sont loin d’avoir tous été rendus publics, et certaines demandes d’accès restent sans réponse, selon le rapport, qui insiste sur l’indispensable souveraineté des données (soit le fait que les Autochtones aient le contrôle sur les données les concernant).
« Le gouvernement se cache parfois derrière les lois sur la protection de la vie privée. C’est une barrière énorme, qui ralentit le travail. Les données relatives aux hôpitaux indiens, notamment, ne sont pas partagées, sous prétexte qu’une action collective a été intentée contre le fédéral à ce sujet en 2018. Mais légalement, cela n’empêche pas de donner accès aux registres », regrette l’interlocutrice spéciale, précisant que c’est souvent dans ces établissements que les enfants succombaient.
Travail de détective

Pensionnat de Fort Resolution, Territoires du Nord-Ouest. Photo: Wikimedia Commons
L’enjeu est immense, car seuls les témoignages d’anciens pensionnaires, croisés avec les informations des archives, peuvent réellement aider à retracer les parcours de ces petits et petites. C’est sur ces traces historiques que travaille Jérôme Melançon, professeur en études francophones et interculturelles à l’Université de Regina. À la demande de la Nation autochtone de Cowessess, qui est anglophone, il vient d’achever une mission colossale : traduire du français vers l’anglais plus de 40 000 documents de la congrégation des oblats de Marie-Immaculée, qui dirigeait la majorité des pensionnats catholiques canadiens, dont ceux de Marieval et de Kamloops.
Beaucoup de ces papiers sont conservés à Winnipeg, au CNVR. « Ce qui est difficile, c’est qu’on ne sait pas ce qu’on cherche exactement, dit le chercheur, qui a pu rémunérer une équipe étudiante pour l’aider grâce à une bourse du Conseil de recherches en sciences humaines. On s’intéresse à tout : il y a beaucoup de lettres internes, des rapports d’inspection du provincial, des journaux, des cahiers personnels… Souvent, ce sont des documents manuscrits, avec des fautes, des mots de vieux français. Il y a aussi du vocabulaire lié à l’agriculture, car les écoles étaient des lieux de travail. »
Comme pour les membres du groupe de travail de l’ACA, cette tâche ne fait pas partie du travail universitaire officiel de Jérôme Melançon. Rien de tout ça n’est destiné à être publié ou diffusé au-delà de la communauté mandataire. Et « on travaille avec les gens de la communauté pour savoir comment ils veulent qu’on leur présente l’information. C’est un peu comme une bombe, quand on met les choses noir sur blanc ».
Cette fastidieuse lecture permet en outre de faire le lien entre les politiques abstraites du gouvernement et l’expérience des enfants qui étaient captifs, précise le chercheur. « Pour la communauté, c’est important de ne pas seulement avoir des noms et des causes de décès, mais de savoir aussi ce que faisaient les enfants au quotidien, qui venait les visiter, qui était embauché, quels étaient les liens avec le voisinage… Ça aide à limiter la colère et la douleur », souligne-t-il.
À quelques semaines de la fin de son mandat, Kimberly Murray plaide pour que le financement fédéral des recherches, prévu jusqu’en 2025, devienne pérenne. « C’est important aussi de continuer à financer des rassemblements de survivants, pour raconter, échanger sur les démarches, et comprendre cette dynamique de génocide et de crimes contre l’humanité, qui s’est répétée dans tout le pays. Il y a aussi une part de guérison là-dedans. »
À chacune de ces rencontres, elle entend des histoires de famille déchirantes. Et elle met la main à la pâte, en cherchant elle-même des noms dans les bases de données. « Le CNVR possède cinq millions de dossiers [fournis par le gouvernement du Canada]. Mais il n’est pas très bon pour répondre aux demandes. Les gens doivent remplir des formulaires, attendre des mois, donc quand je peux chercher directement, je le fais. Quelqu’un devra continuer ce travail après moi. »
Récemment, une femme lui a demandé de retrouver la trace de son frère ; Mme Murray a trouvé qu’il avait été enterré dans une fosse commune vers Toronto. Elle compte aller sur le site avec cette femme et un de ses frères encore en vie, octogénaire. « La plupart des gens ne veulent pas exhumer les corps parce qu’ils ne veulent pas perturber le site, explique-t-elle. Mais ils veulent se rendre à la sépulture, la protéger. Et ils veulent faire des cérémonies, pour ramener l’esprit du défunt à la maison. » Un retour qui n’a que trop tardé.
Photo au début de l’article : Sturgeon Landing, Saskatchewan, 1946. Crédit : Archives de la Société historique de Saint-Boniface (ASHSB)/0484/SHSB124868
Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, qui finance les travaux de chercheuses et chercheurs d’ici, dont certains cités dans ce texte, soutient financièrement Québec Science dans sa mission de couvrir des sujets liés aux sciences humaines. Le magazine conserve son indépendance dans le choix et le traitement des sujets.






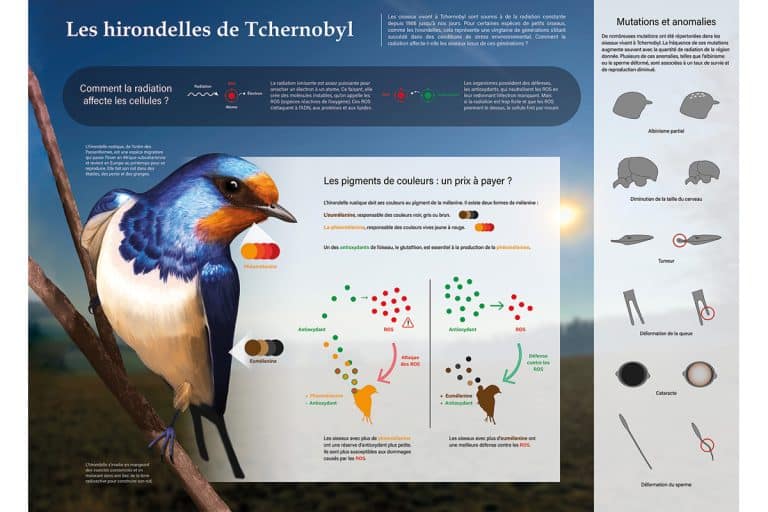


Et pourtant, à Kamloops comme ailleurs, on n’a pas déterré de cadavres là où les géoradars ont trouvé des altérations du sol. Ce n’est pas de la science, mais de la propagande! On attend toujours les preuves.
Par ailleurs, il faudrait comparer le traitement des enfants dans les pensionnats autochtones avec les pensionnats non autochtones, et il ne faut pas oublier que la tuberculose tuait beaucoup d’enfants en ces temps-là.
Sur ce sujet des enfants supposément enterrés, voir la chronique de JF Lisée (24 avril 2024) Le livre maudithttps://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/811514/chronique-livre-maudit
et le livre Grave Error: How The Media Misled Us (and the Truth about Residential Schools) (Champion et Flanagan, 2023).Voir aussi les articles suivants, dans la revue Quillette:
(22 juil 2022) A Media-Fueled Social Panic Over Unmarked Graveshttps://quillette.com/2022/07/22/how-fake-news-in-the-new-york-times-led-to-a-canadian-social-panic-over-unmarked-graves/
(1 mars 2024) Looking Back at the ‘Unmarked Graves’ Social Panic of 2021https://quillette.com/2024/03/01/looking-back-at-the-unmarked-graves-social-panic-of-2021/
(20 juin 2023) In Canada, Asking for Evidence Now Counts as ‘Denialism’https://quillette.com/2023/06/20/rebranding-inconvenient-truths-as-denialism/
Michel Belley, Sceptiques du Québec